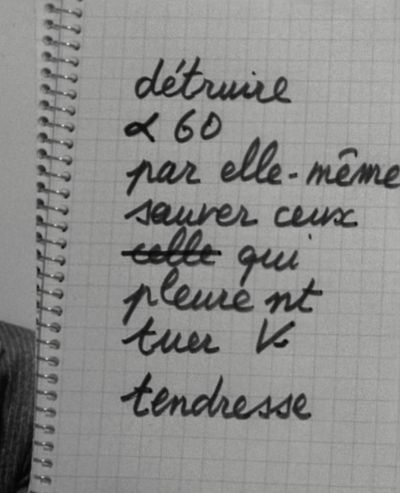« Plutôt que d’amour, parlons de sentiments. » En portant ce point de vue à la connaissance de Daphné, la compagne de son cousin venue l’accueillir en l’absence de ce dernier, Maxime ne songe qu’à sa propre vie affective et à celle de ses amis. Il est loin, alors, de se douter que cet aveu parviendra à l’oreille de la jeune femme sous la forme d’une tendre prédiction. L’amante qui se pensait fidèle ira donc elle aussi rejoindre la cohorte des polyamoureux qui s’ignorent. De cette prévalence du pluriel dans les affaires de cœur, Emmanuel Mouret nous dresse un Banquet de son cru dans un savoureux chassé-croisé où – belle ironie – le désir a rarement le dernier mot.
L’amour s’arrête au bord des lèvres. Passé le seuil du premier baiser, le désir manque soudain d’imagination.
À peine se sont-ils rencontrés que Daphné et Maxime n’ont eu qu’un seul désir, celui de se raconter leurs déboires amoureux. Enceinte de trois mois, la jeune femme se morfond à la campagne. En l’absence du père de son futur enfant, elle ne se fait pas prier pour servir de guide au cousin de ce dernier, aiguillonnée qu’elle est par la double réputation qui précède le jeune homme, d’aspirant écrivain et d’amoureux éconduit .
Du temps devant soi mais pas trop, des jolies personnes dans des jolis décors, un doux soleil de printemps : il n’est pas de situation plus propice aux confidences ni de terrain plus favorable à l’aventure. Car s’il se trame bien des choses dans une conversation que les interlocuteurs eux-mêmes ignorent, ou feignent d’ignorer (par politesse, par intérêt ou par esprit de réserve), il s’agit d’un principe fécond dont Emmanuel Mouret se fait un plaisir d’user comme d’un ferment pour une trame d’actions presque purement verbales. Ce regard plein de malice dédié au langage dans son rapport à la chose amoureuse, on dit à juste titre qu’il doit beaucoup à Rohmer. Reconduit à une certaine forme de théâtralité consciente, le cinéma peut s’exprimer avec sérieux sous une verve ludique qui relativise la gravité éventuelle de ses sujets. Une telle tactique produit des films dont le charme semble émaner tant du jeu des acteurs que d’un montage de scènes vif et rythmé.
Long de quatre jours, le tête-à-tête bucolique, au terme duquel Daphné et Maxime n’auront plus de secrets l’un pour l’autre, advient dans le plus strict respect de la tradition du récit à tiroirs. Par l’entremise de ce couple qui n’en est pas un, une aimable causerie se mue en bal d’intrigues. Celui-ci embrasse une bonne dizaine de personnages.

Les ritournelles de l’amour
Ils ont beau faire, tous autant qu’ils sont, les Louise, Sandra, Victoire, François, Gaspard, Stéphane et les autres, la carte du tendre ne cesse de leur tomber des mains. Mains qu’ils ont, de toute évidence, plus émues que baladeuses. En guise de consolation, et comme pour nous assurer que personne n’est dupe de la banalité de ce que vivent ces personnages, un piano espiègle s’emploie à rejouer dans leur dos les airs les plus connus du répertoire romantique, Chopin, Tchaïkovski, Schubert, Puccini, mais aussi Debussy et Satie. Est-il seulement possible d’innover lorsqu’on obéit aux lois de l’attraction ?
Innover, de toute façon Emmanuel Mouret ne prétend pas le faire, lui qui rechigne à se montrer le contemporain de son époque. En cela, malgré des préoccupations communes, il prend résolument ses distances vis-à-vis d’un cinéma sensible aux tendances actuelles et à ce qui, dans notre quotidien, constitue des micro-révolutions ou des remises en cause des normes du passé. Pour prendre un exemple récent, le film Chambre 212 de Christophe Honoré se révèle assez proche des Choses qu’on dit sur un plan thématique, confrontant la notion de fidélité à la multiplicité des liens qui se tissent au cours d’une existence. Pour en délibérer, le cinéaste convoque une galerie de caractères à la fois tragiques et drôles, dotés d’une force dionysiaque où s’exprime un optimisme cru, un entêtement joyeux jusque dans la honte et la souffrance. Sans sacrifier à la complexité des relations humaines, Emmanuel Mouret ne parvient toutefois pas à arracher ses personnages d’un schéma hétérosexuel centré sur le couple, défini de préférence par les liens du mariage ou de la cohabitation.

Passé ce constat, Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait peut bien être porteur d’un fatalisme moral un peu triste, sur un mode plus intellectuel, le film n’en est pas moins exempt de joie et d’invention. Ainsi, le divorce entre les actes et le discours, sur lequel insiste le titre, loin de diviser le plaisir, le double en séparant ses sources. Cette jouissance par la parole compte bien quelques adeptes dans le cinéma actuel, Desplechin et Honoré en tête, nous venons de le voir. Mais les maîtres de Mouret appartiennent résolument au passé : Diderot (convoqué dans Mademoiselle de Joncquières), et Rohmer encore, dont le dispositif conversationnel se voit ici démultiplié en une polyphonie plus joueuse que philosophique. Si peu moderne qu’il paraisse (ou intemporel, c’est comme on veut), détaché des questions matérielles, le cinéma de Mouret ne se fait pas pour autant l’écho d’un jugement social tel qu’il s’illustre avec une cruauté sournoise dans les Liaisons dangereuses. D’une éventuelle affinité avec un Choderlos de Laclos ne subsiste dès lors que l’attrait pour une langue toute puissante, un verbe capable de faire et de se faire jouir, quand bien même il rencontrerait là sa limite – et sa triste fin. L’amour dirait-on, chez les uns comme les autres, s’arrête au bord des lèvres. Passé le seuil du baiser, le désir manque soudain d’imagination. Personne n’ira jusqu’à se l’avouer, mais c’est là chez Mouret le début de l’ennui, quand la relation bascule dans le charnel. Le désir de l’autre se tend de fils narratifs disséminés dans un être qui n’en a pas toujours conscience, et lorsque ceux-ci deviennent inactifs, qu’ils radotent ou déçoivent, le désir se trouve un nouvel objet. Vieille histoire.

La sobriété des décors, intérieurs comme extérieurs, déterminés par des tons crème sur lesquels la couleur ne se pose jamais au hasard (une ceinture d’un rouge indiscret pour Louise / Émilie Dequenne) et le jeu en demi-teinte des acteurs (magnifique Camélia Jordana, dans un contre-emploi qui lui va bien) soulignent cette recherche d’un classicisme où tout peut se dire avec mesure et délicatesse. Sans doute le drame n’a-t-il pas lieu d’être lorsqu’on pense que rien jamais ne changera. Le réalisateur préfère s’attarder sur les raisons et les contradictions de chacun, épousant tour à tour les revirements de ses protagonistes comme si à chaque fois c’était pour de bon. Certes, l’Amour ne résiste pas aux «choses » (qu’on dit, qu’on fait), mais pourquoi faudrait-il leur en sacrifier la délicieuse illusion ? Dans ce film, la voie du libertinage demeure invisible, et s’il elle devait apparaître, elle ferait probablement horreur à ceux qui, pour l’emprunter, ne devraient toutefois pas trop modifier leur manière d’être. Ce cynisme-là n’est pas du ressort des protagonistes de Mouret. C’est donc au prix d’une grande peine, qui est de se décevoir sans cesse, qu’ils restent fidèles à leurs chemins de désir. « En amour, nous dit-on, il n’y a pas de règle ». Et cette sagesse est bien la seule que délivre un film pourtant moins enclin à l’insouciance qu’à la mélancolie.

 Egon Schiele, L’étreinte, 1917 (détail)
Egon Schiele, L’étreinte, 1917 (détail)
 Ada & Souleiman (Mama Bineta Sané & Ibrahima Traoré)
Ada & Souleiman (Mama Bineta Sané & Ibrahima Traoré) Souleiman (Ibahima Traoré)
Souleiman (Ibahima Traoré) I Walked with a zombie, Jacques Tourneur
I Walked with a zombie, Jacques Tourneur Ada (Mama Bineta Sané)
Ada (Mama Bineta Sané) Issa (Amadou Mbow)
Issa (Amadou Mbow)










 Oskar Kokoschka, Mädchenbildnis (1913) : « Je regrette votre regard posé sur moi. La maladie doit pouvoir prendre en paix. »
Oskar Kokoschka, Mädchenbildnis (1913) : « Je regrette votre regard posé sur moi. La maladie doit pouvoir prendre en paix. » Oskar Kokoschka, La fiancée du vent (autoportrait avec Alma Mahler), 1913 « Quelque chose comme une tempête, voilà, un grand vent : ce que je suis. »
Oskar Kokoschka, La fiancée du vent (autoportrait avec Alma Mahler), 1913 « Quelque chose comme une tempête, voilà, un grand vent : ce que je suis. » « Tes yeux sont revenus d’un pays arbitraire où nul n’a jamais su ce que c’est qu’un regard »
« Tes yeux sont revenus d’un pays arbitraire où nul n’a jamais su ce que c’est qu’un regard » « – Amoureux ? Qu’est-ce que c’est ?
« – Amoureux ? Qu’est-ce que c’est ? – Non, ça je connais ; c’est la volupté.
– Non, ça je connais ; c’est la volupté. – La volupté est une conséquence, elle n’existe pas sans l’amour.
– La volupté est une conséquence, elle n’existe pas sans l’amour.